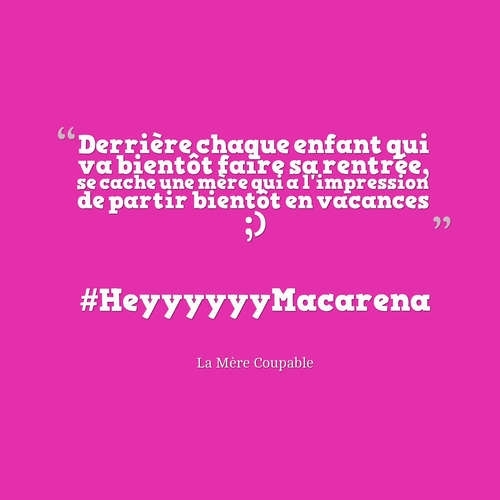Femmes - Page 36
-
Poétique?

-
Maman lucide
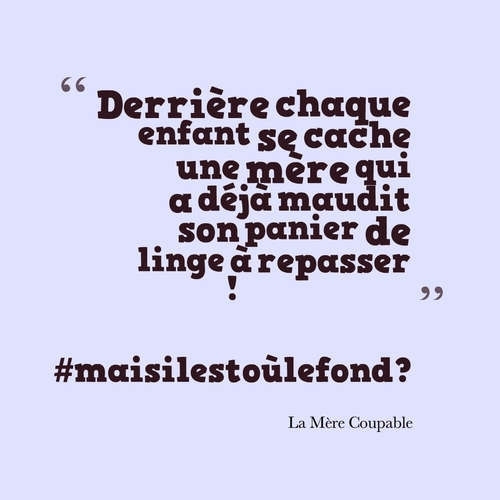
-
Vacances ratées

-
Aude, berceau de ma famille maternelle

Courage!
Pensées émues à tous mes cousins
-
Vacances ratées
 Lien permanent Catégories : Autres animaux, Femmes, Gens, Hommes, Humour, Loisirs, Voyage 0 commentaire
Lien permanent Catégories : Autres animaux, Femmes, Gens, Hommes, Humour, Loisirs, Voyage 0 commentaire -
Vacances ratées

-
Maman lucide
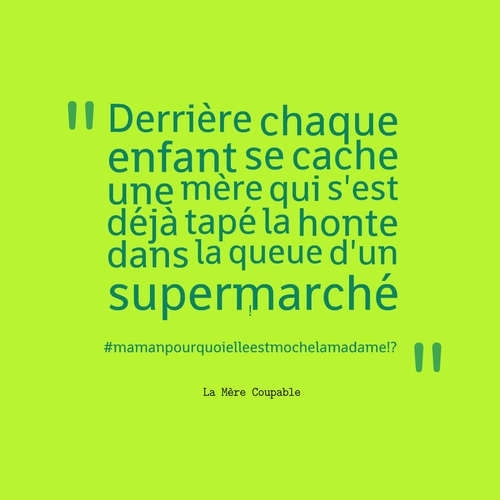
-
Maman lucide