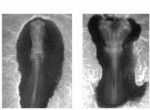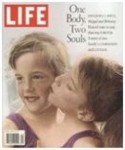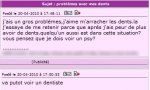L'addiction au Coca-Cola peut-elle être mortelle?
Une Australienne, accro au Coca-Cola, est décédée d'une crise cardiaque en février 2010. Selon le rapport médical, sa consommation excessive du soda pourrait avoir provoqué sa mort.
Huit à dix litres de Coca-Cola. C'est ce que buvait quotidiennement Natasha Harris, une jeune Australienne installée avec son compagnon en Nouvelle-Zélande. "Elle était accro au Coca-Cola (...) La première chose qu'elle faisait en se levant, c'était de boire un verre de Coca dans son lit et la dernière chose qu'elle faisait avant de se coucher, c'était d'en boire un", raconte son compagnon dans The Guardian.
Un régime dramatique qui a, selon le Dr Dan Mornin, déclenché la crise cardiaque qui l'a frappée à seulement 30 ans. Ce médecin attribue son décès à sa surconsommation de Coca-Cola. Cette addiction aurait, selon lui, provoqué une hypokaliémie, c'est-à-dire un taux trop bas de potassium dans le sang, pouvant provoquer des problèmes cardiaques.
L'ingestion de fortes doses de caféine, une molécule présente dans le soda, pourrait aussi être responsable de sa mort. D'autant que d'après son compagnon, sa mauvaise hygiène de vie ne s'arrêtait pas là: cette mère de huit enfants mangeait très peu et fumait plus de trente cigarettes par jour.
Le Coca-Cola: un vrai additif?
Le Coca-Cola peut-il donc être un considéré comme une substance addictive et dangereuse à l'instar de l'alcool ou la drogue? "Une addiction biologique à un soda n'est pas scientifiquement prouvée", explique le Dr. Sarah Coscas, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
"Mais dans le cas de cette femme, une addiction au sucre est possible vues les quantités absorbées par cette personne. Une habitude à vivre sous caféine à haute dose est aussi envisageable, mais ce n'est pas à proprement parlé une addiction."
Selon elle, ce n'est donc pas tant la boisson elle-même qui est en cause, mais tout un ensemble de troubles alimentaires qui ont conduit la jeune femme à souffrir de nombreuses carences.
Coca-Cola se défend
Selon le Dr Martin Sage, cité dans The Guardian, ce cas tend pourtant à prouver "qu'une consommation excessive, sur le long ou le court terme, de soda type Coca-Cola peut causer des symptômes dramatiques. Et que les risques sont importants pour qu'ils deviennent fatals".
De son côté, Coca-Cola défend évidemment son produit. Karen Thompson, la représentante de la marque en Océanie, a déclaré "nous sommes d'accord avec les informations découlant du rapport sur ce décès. L'ingestion excessive de tous produits alimentaires, y compris l'eau, sur une courte période, additionnée à une mauvaise hygiène de vie et une santé négligée, peut-être considérablement dommageable. Mais une consommation raisonnable de Coca-Cola n'est en aucun cas dangereuse pour la santé". A consommer avec modération.